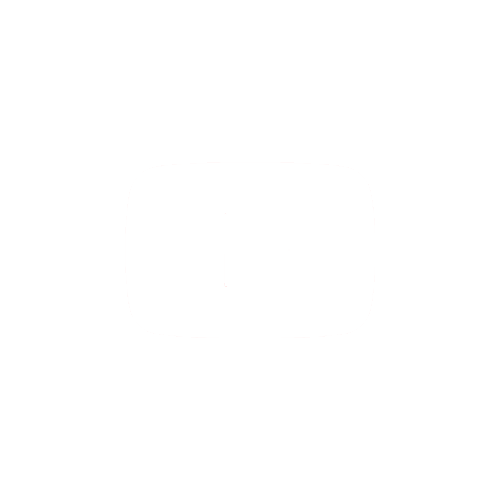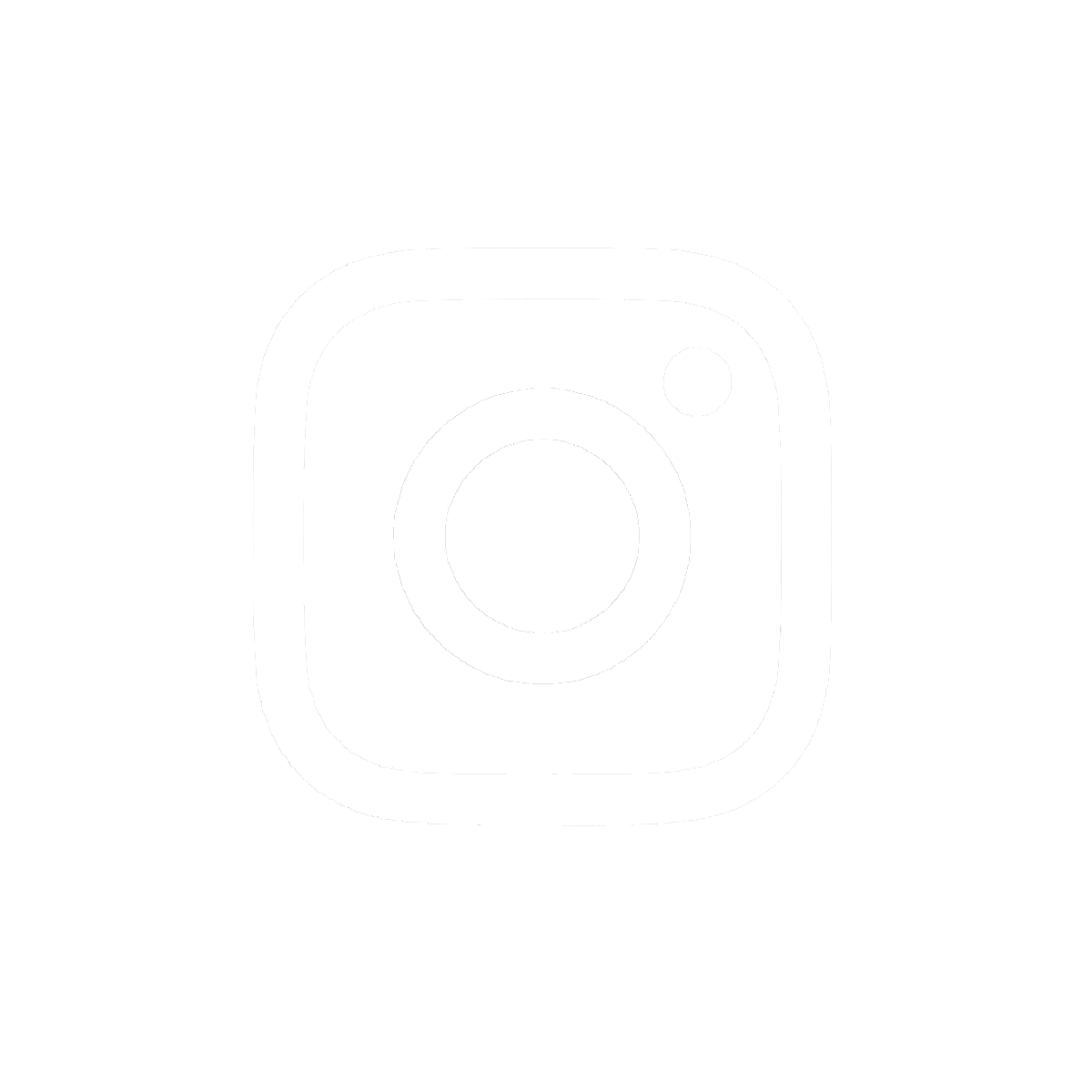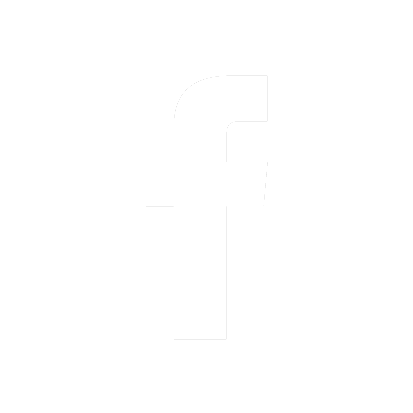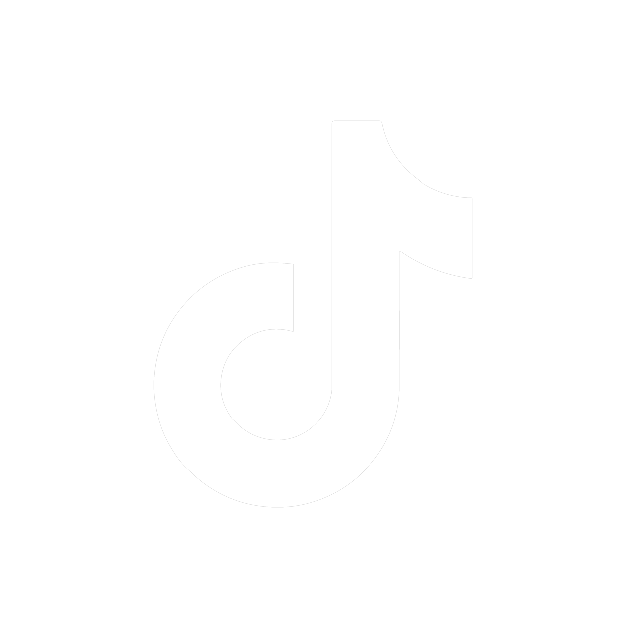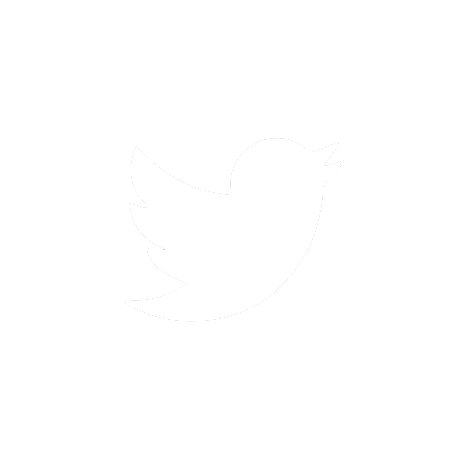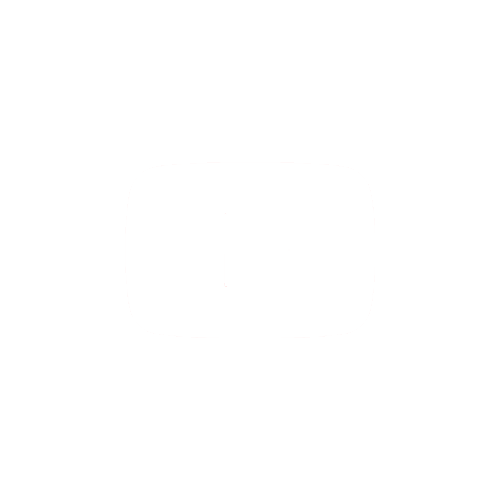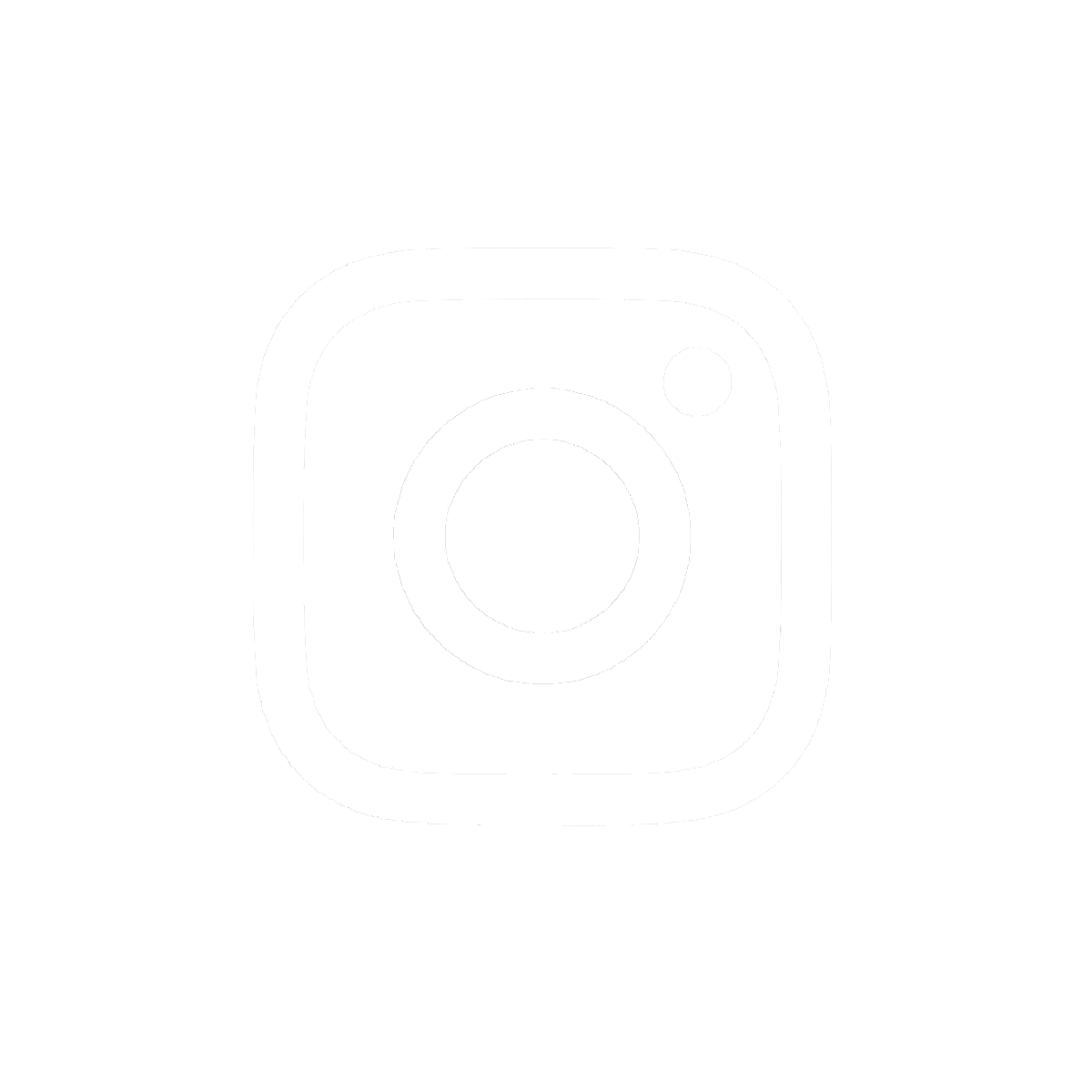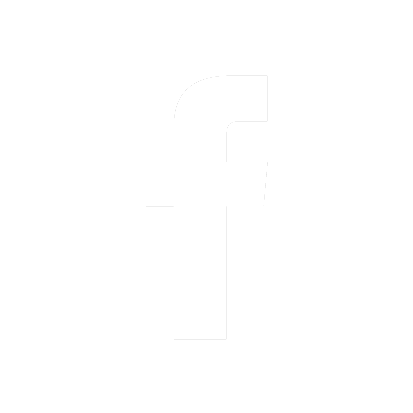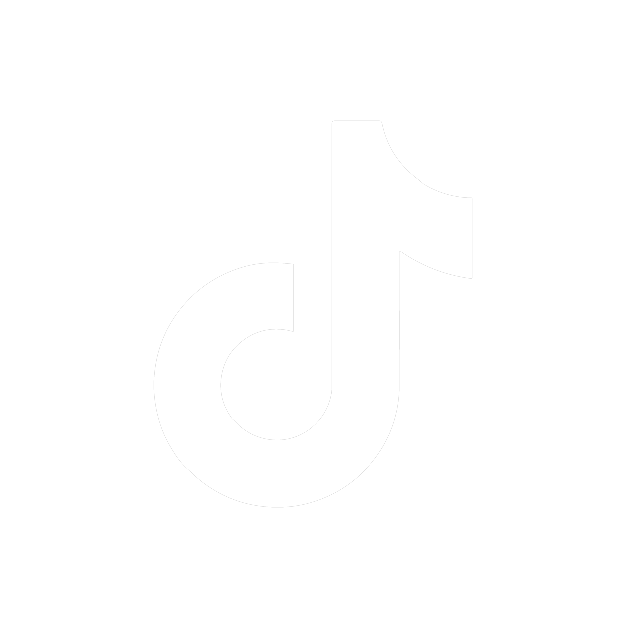Le récent appel « Travail : démocratiser, démarchandiser, dépolluer » initié par Isabelle Ferreras, Dominique Méda, and Julie Battilana, publié en 25 langues dans 41 journaux nationaux de 36 pays, signé par plus de 5500 personnalités dans le monde, a eu le mérite d’associer deux mots : démocratie et travail. Démocratiser le travail, démocratiser l’entreprise, sont des idées discutées dans de nombreux réseaux, y compris au sein DiEM25, depuis des années. Il faut donc rendre hommage à cet appel pour la résonance qu’il leur donne. Je ne discuterai pas ici de cet appel en tant que tel, ni de ses limites, mais de quelques idées préconçues qui reviennent fréquemment lorsqu’on parle de démocratie dans l’entreprise, afin de clarifier de quoi il s’agit et pourquoi c’est un outil essentiel pour penser la société postcapitaliste.
La démocratie au travail n’est pas un projet de nationalisation
Commençons par un rappel évident : la démocratie au travail n’est un projet de nationalisation, et n’a rien à voir avec les nationalisations. Des gouvernements de gauche comme de droite ont pratiqué des nationalisations, sans que cela ajoute une once de pouvoir aux salarié·es de ces entreprises. Les privatisations sont généralement défavorables aux salarié·es parce qu’elles sont l’occasion de réorganisations brutales, mais il ne s’ensuit pas que les nationalisations soient favorables. Elles sont au mieux un outil de pilotage économique, le plus souvent un moyen de remettre à flot des entreprises avant de les renvoyer dans le domaine privé. Fonder un programme sur les nationalisations a toujours été une erreur dans laquelle la gauche s’est fourvoyée. Ou alors, il faut dire les choses franchement, ce n’est pas un programme en faveur du monde du travail, mais du renforcement de la bureaucratie de l’État.
En France, les fameux débats pour le programme commun de la gauche en 1972, qui marque encore les imaginaires de manière plus ou moins consciente, a régulièrement achoppé sur le nombre d’entreprises à nationaliser, la place des salarié·es dans leur gestion étant laissée à des formules vagues. Après 1981, ces nationalisations massives, payées au prix lourd, n’ont guère tenu que quelques années ; d’autres mesures ont donné plus de poids aux salarié·es dans l’entreprise, notamment au niveau syndical, mais de manière tout à fait indépendante des nationalisations. Autant dire qu’en faire la panacée de la gauche, c’est mentir au monde du travail.
La démocratie au travail n’est pas la gestion des problèmes par les salarié·es pour les profits des actionnaires.
La question de la démocratie au travail est régulièrement discutée en termes de gestion des ressources humaines, de management, pour favoriser l’autonomie des salarié·es. Cela passe par l’assouplissement des fonctionnements hiérarchiques, l’encouragement au travail en équipe, le « mode projet » et ainsi de suite. C’est une manière de lâcher du lest, voir de laisser les salarié·es se débrouiller avec les problèmes sur le terrain, sans changer fondamentalement la structure de l’entreprise : elle reste orientée vers le profit des actionnaires, ou vers des objectifs fixés au sommet. C’est sans doute une manière de reconnaître que la démocratie au travail est la prochaine étape historique, d’admettre que les fonctionnements autoritaires sont dépassés, mais le problème reste entier : le critère reste celui des profits et le niveau de direction reste en dehors de la sphère démocratique. Les salarié·es sont simplement prié·es d’autogérer les problèmes d’une manière satisfaisante pour les actionnaires.
La démocratie dans l’entreprise n’est pas le recours au référendum par le patron
Ces dernières années, on a vu se développer une méthode particulièrement perverse : le recours au référendum par les patrons. Curieusement, ce n’est jamais un référendum pour proposer des améliorations des conditions de travail ou de rémunération. Non, en général, la question revient à « est-ce que vous acceptez une baisse de salaire ou bien vous préférez qu’on ferme la boutique ? ». Inutile de dire que dans la plupart des cas, l’immense majorité des employé·es acceptent la baisse de salaire. Cela permet de court-circuiter les négociations avec les syndicats, puisque le patron peut ensuite dire : « vous voyez bien, ils sont d’accord avec nous », quand bien même les procédures légales n’ont pas été appliquées. C’est donc un moyen de faire accepter les coupes franches par les salarié·es tout en attaquant frontalement les organisations syndicales représentatives. Ce type de pratique n’a rien à voir avec un référendum, si ce n’est le nom. C’est une forme de chantage, une variante capitaliste du brigandage, « la bourse ou la vie » en version managériale.
Ces derniers temps, on a beaucoup parlé en France de référendum d’initiative citoyenne. Un référendum d’initiative salariée, qui permettrait aux employé·es d’imposer au patron leurs revendications, serait une étape beaucoup plus importante pour la démocratie dans l’entreprise que toute forme de référendum d’initiative patronale.
La démocratie au travail ne se limite pas l’extension des droits d’expression des salarié·es
Les droits d’expression des salariés dans l’entreprise sont fort limités. Selon les pays, en Europe, l’activité syndicale a plus oui moins de marge de manœuvre au sein même des locaux de travail et de possibilités d’expression. Nulle part les principes démocratiques de base, telle que la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la transparence sur les rémunérations, ne sont absolument garanties. Le risque d’être licencié est grand pour qui critique son entreprise de manière publique à l’extérieur, et les droits des lanceurs d’alerte peinent à être reconnus. La Confédération européenne des syndicats (ETUC) bataille sur ces questions, qu’elle regroupe volontiers sous le nom de démocratie dans l’entreprise.
Cres droits sont très importants. Ils sont constitutifs de la démocratie, au même titre que le suffrage universel. Etablir une véritable démocratie au travail nécessite de les garantir, de les sanctuariser dans la constitution. Mais ils ne suffisent pas, justement, s’ils ne sont pas accompagnés du suffrage universel, de la libre désignation des gérant·es des entreprises par l’ensemble des personnes qui y travaillent. Ces droits se complètent : une élection libre nécessite la possibilité de débattre des priorités de l’entreprise, des souhaits des employé·es, des qualités et des défauts des candidats. Tout ce qui étend ces droits d’expression dans et sur l’entreprise prépare à la démocratie, sans s’y résumer.
La démocratie au travail n’est pas la cogestion
Cogestion est un mot à géométrie variable, mais qui implique toujours une participation des salarié·s, par le biais de leurs représentant·es, aux instances de direction d’une entreprise ou d’une administration. L’exemple le plus célèbre est le système de cogestion mis en place dans toutes les entreprises de plus de 2000 salarié·es en Allemagne depuis 1976. Le conseil de surveillance des entreprises cogérées comprend à part égale des salarié.es et des actionnaires, mais seuls ces derniers décident de la répartition des profits… Rappelons qu’en France, ce n’est que depuis 2010 que les grandes entreprises ont l’obligation d’avoir deux, représentant·es des salarié·es dans leur conseil d’administration.
Malgré ses limites, cette cogestion s’est révélée efficace, par exemple, pour résister à la crise de 2008 : sous la pression des syndicats, les entreprises cogérées ont moins licencié que les autres, limitant ainsi l’impact du chômage. Les salarié·es, qui ne peuvent pas se contenter comme les actionnaires d’investir leur argent ailleurs, gèrent l’entreprise de manière plus prudente. Au début des années 80, lorsque de nombreux gouvernements européens penchaient à gauche, le Parlement européen a envisagé de généraliser ce système en Europe, mais ce projet n’a jamais abouti.
Les critiques de la cogestion portent sur des points importants : les syndicats impliqués dans la cogestion tendent à perdent de leur mordant et adopter un point de vue gestionnaire qui diffère peu de celui des actionnaires ; les syndicalistes impliqués dans les hautes sphères de la gestion des entreprises finissent par adopter la même mentalité que les administrateurs. Tout cela n’est pas faut, et pèse sur la méfiance que la cogestion inspire dans certaines culture syndicales.
Même si elle peut être l’un des nombreux chemins qui mènent à la démocratie dans l’entreprise, la cogestion n’en est qu’un ersatz. Les salarié·es n’y disposent somme toute que d’un droit de regard un peu étendu sur les affaires de l’entreprise, mais le système archaïque du versement de dividendes à des actionnaires y reste en vigueur. En outre, même en Allemagne où c’est devenu un pilier du système économique, l’immense majorité des entreprises est trop petite pour bénéficier de la cogestion.
Le principe même de la cogestion est vicié : il s’agit de faire participer les salarié·es à la gestion des entreprises pour les profits des actionnaires. Il n’y a pas lieu de s’y opposer quand une opportunité s’ouvre, ou de la refuser dans le cadre d’une transition vers l’économie démocratique, mais ça ne devrait pas constituer un objectif.
La démocratie au travail n’est pas la généralisation des coopératives Dès le début du XIXe siècle, des ouvrièr·es ont cherché à créer des îlots de socialisme, à mettre en œuvre la démocratie dans l’atelier en fondant des coopératives de production. Elles sont une part indissociable de l’histoire du mouvement ouvrier. Des coopératives ont fait partie des deux internationales, et certaines ont même soutenu brièvement le bolchevisme avant sa caporalisation. D’autres sont nées au sein du mouvement ouvrier chrétien. Aujourd’hui, les coopératives continuent leur chemin avec succès, puisqu’elles se montrent plus solides que le secteur privé. En France, le slogan de la confédération générale des SCOP, « la démocratie nous réussit » se vérifie dans leur succès économique et leur part est loin d’être marginale dans certains secteurs. C’est l’un des nombreux signes qui montrent que les travailleur-es sont plus qualifiées que les patrons pour faire tourner l’économie.Quelle différence alors entre démocratie dans l’entreprise et coopératives de production ? Les coopératives sont fondées sur la base de la propriété – ce qui est normal, puisqu’elles ont dû s’insérer dans un monde capitaliste fondé lui-même sur la propriété privée des moyens de production. Dans certains cas, le système est dévoyé : un groupe restreint de coopérateur·es détient le pouvoir et se comportent en véritables patrons pour des salarié·es dépourvu·es de pouvoir, souvent avec des contrats courts.Au contraire, la démocratie dans l’entreprise est un principe, qui doit s’appliquer à l’ensemble des entreprises (et des administrations, d’ailleurs), à l’ensemble des travailleur-es. Elle n’est pas fondée sur la propriété – celle-ci étant parfaitement inutile si l’on définit les entreprises comme un bien commun de la société – mais sur des règles de fonctionnement qui garantissent l’expression des travailleur·es et leur contrôle sur le fonctionnement de l’entreprise. Elle repose fondamentalement sur une décision politique, voir sur un choix constituant de la société, pas sur la multiplication de créations de coopératives.Inutile d’ajouter que la proposition de favoriser la reprise sous une forme coopérative des entreprises en faillite, qui figure régulièrement dans les programmes de partis de gauche, n’a pas grand rapport avec cette stratégie. En France, cette possibilité légale existe et fonctionne, avec des résultats mitigés et quelque success story, ne serait-ce que par la question du financement reste centrale. Mais une entreprise en difficulté reste une entreprise en difficulté, même si les critères des travailleur-es ne sont pas ceux des patrons. Cela participe donc, au fond, d’un principe classique du capitalisme : socialisation des pertes, privatisation des profits.
La démocratie au travail n’est le droit pour les entreprises de décider de tout
Ça, c’est le capitalisme : malgré des législations nationales et des normes internationale plus ou moins contraignantes, les entreprises capitalistes hésitent rarement à piller les ressources non renouvelables, polluer l’atmosphère, le sol et l’eau, exploiter les salarié·es. Il est fréquent qu’elles passent outre le droit du travail, la législation sur l’environnement ou la fiscalité. Pour les entreprises transnationales, c’est encore plus simple : elles peuvent pratiquer allégrement le greenwashing, faire des campagnes pour vanter leur contribution à l’écologie dans les pays riches, tout en détruisant l’environnement dans les pays plus pauvres, et pratiquer des politiques sociales décentes pour les employé·es du siège social tout en surexploitant celles et ceux des pays où elles sont implantées, directement ou via leurs filiales.
Un système basé sur la démocratie dans l’entreprise ne signifie pas que les employé·es peuvent décider, en toute liberté, de poursuivre ces politiques polluantes ou destructrices. Les décisions sur les sujets qui concernent l’environnement, la biodiversité, l’emploi dans une région, et ainsi de suite, dans son ensemble doivent être prises au niveau politique, pour la société et non par une entreprise seule. Ce n’est pas aux salarié·es du nucléaire, de décider si nous devons employer cette énergie ou non, par exemple.
La démocratie dans l’entreprise ne doit pas non plus s’arrêter aux frontières de l’Europe. Au contraire, si elle venait à être mise en place en Europe, il faudra s’assurer que les entreprises qui y ont leur siège ou y sont implantées la pratiquent, dans la mesure du possible, dans l’ensemble de leurs sites ET de leurs filiales dans le monde. C’est extrêmement important, car cela évite de créer une « élite démocratique », formée par les salarié·es du siège, qui exploiterait sans vergogne les salarié·es du groupe dans d’autres pays, dans un pur style néocolonial. C’est aussi une manière de favoriser la révolution démocratique et sociale partout dans le monde, d’une manière difficile à combattre par les régimes non-démocratiques.
Conclusion
La démocratie sur le lieu de travail dans l’entreprise est fondée sur l’idée simple que si la démocratie est bonne pour notre société, alors il n’ya pas de raison qu’elle s’arrête aux portes de l’entreprise. C’est le vieux principe du socialisme démocratique, tel l’exprimait Jaurès : « la grande Révolution a rendu les Français rois dans la cité et les a laissés serfs dans l’entreprise ». Cette phrase est souvent citée, mais rarement prise dans toutes ses implications. L’entreprise capitaliste vit encore sous l’ancien régime, il est temps de passer au suffrage universel.
Nicolas Dessaux (collectif national de DiEM pour la France)
Voulez-vous être informés des actions de DiEM25 ? Enregistrez-vous ici!