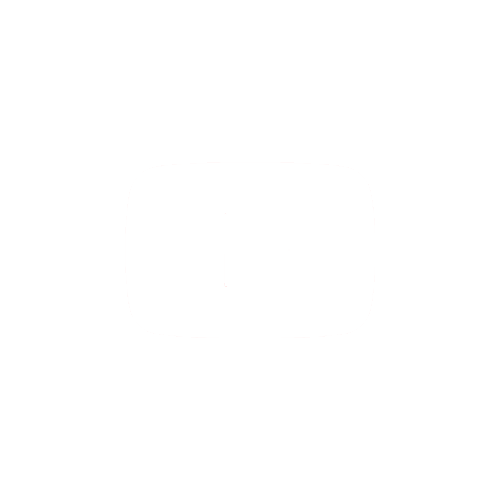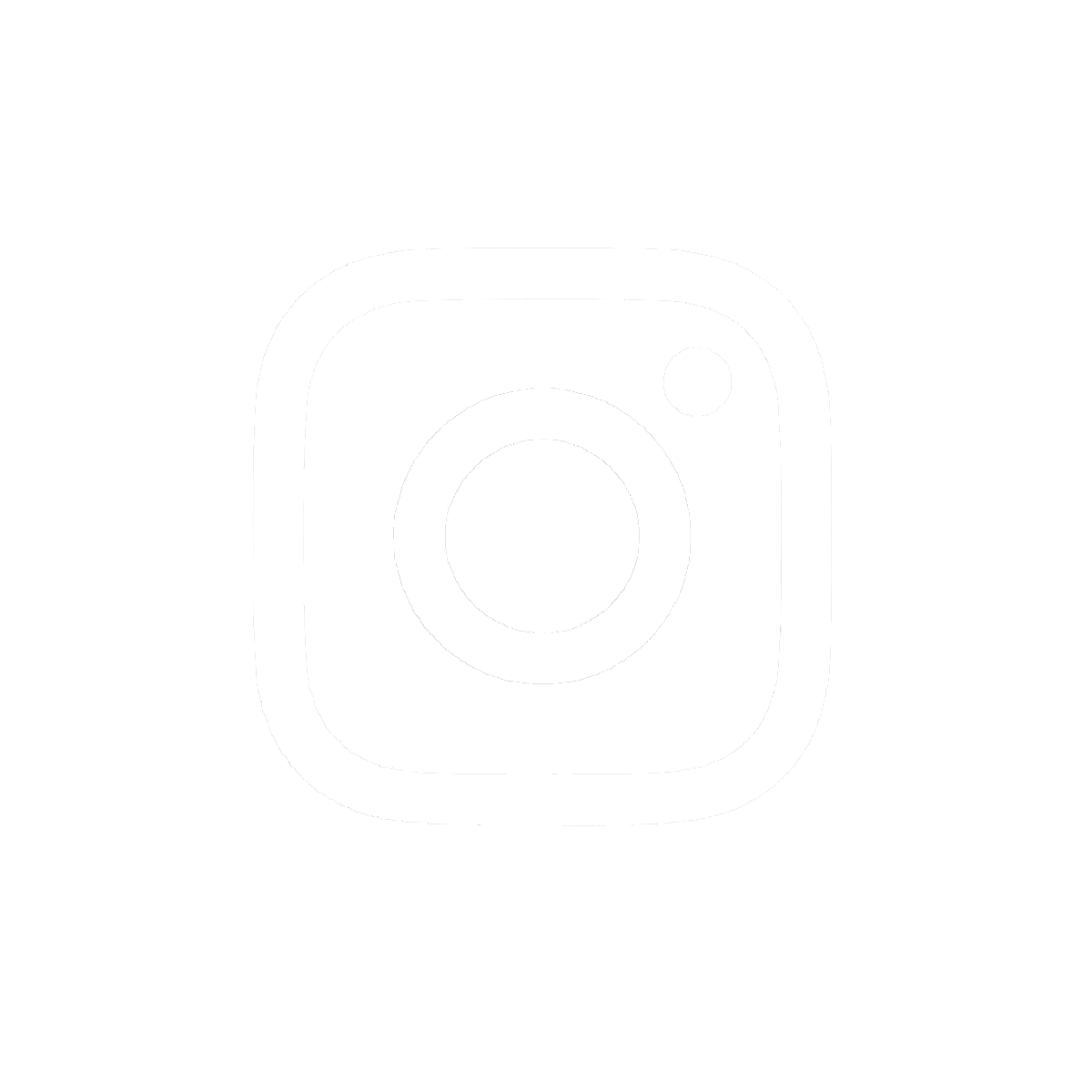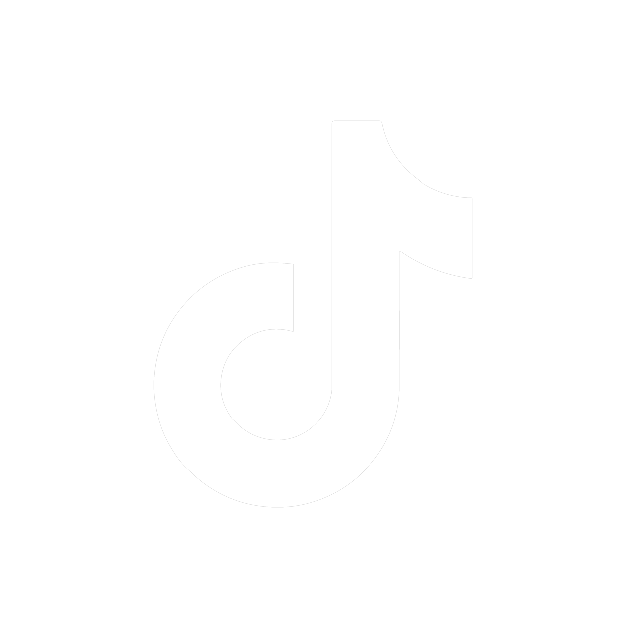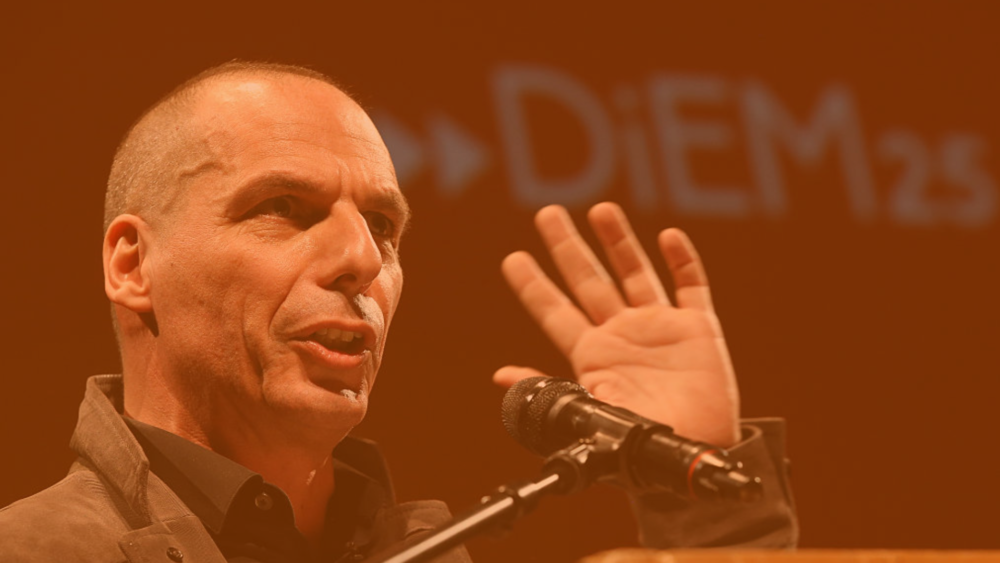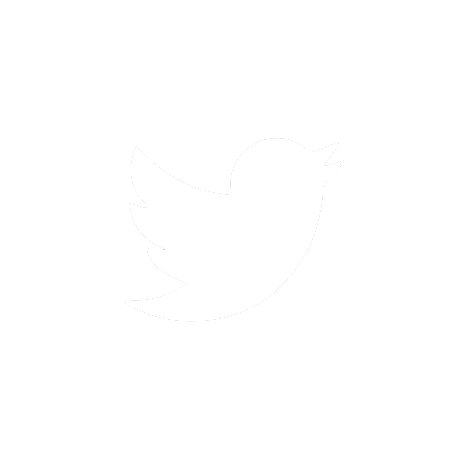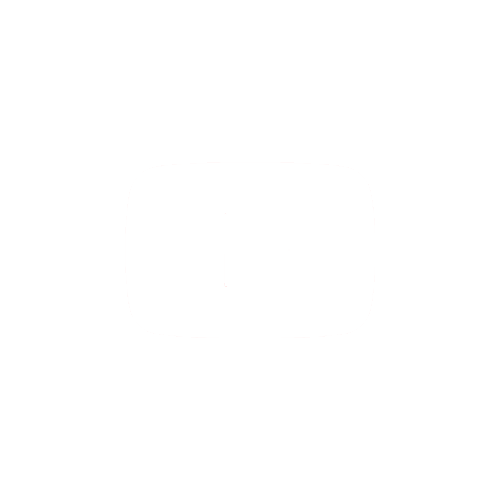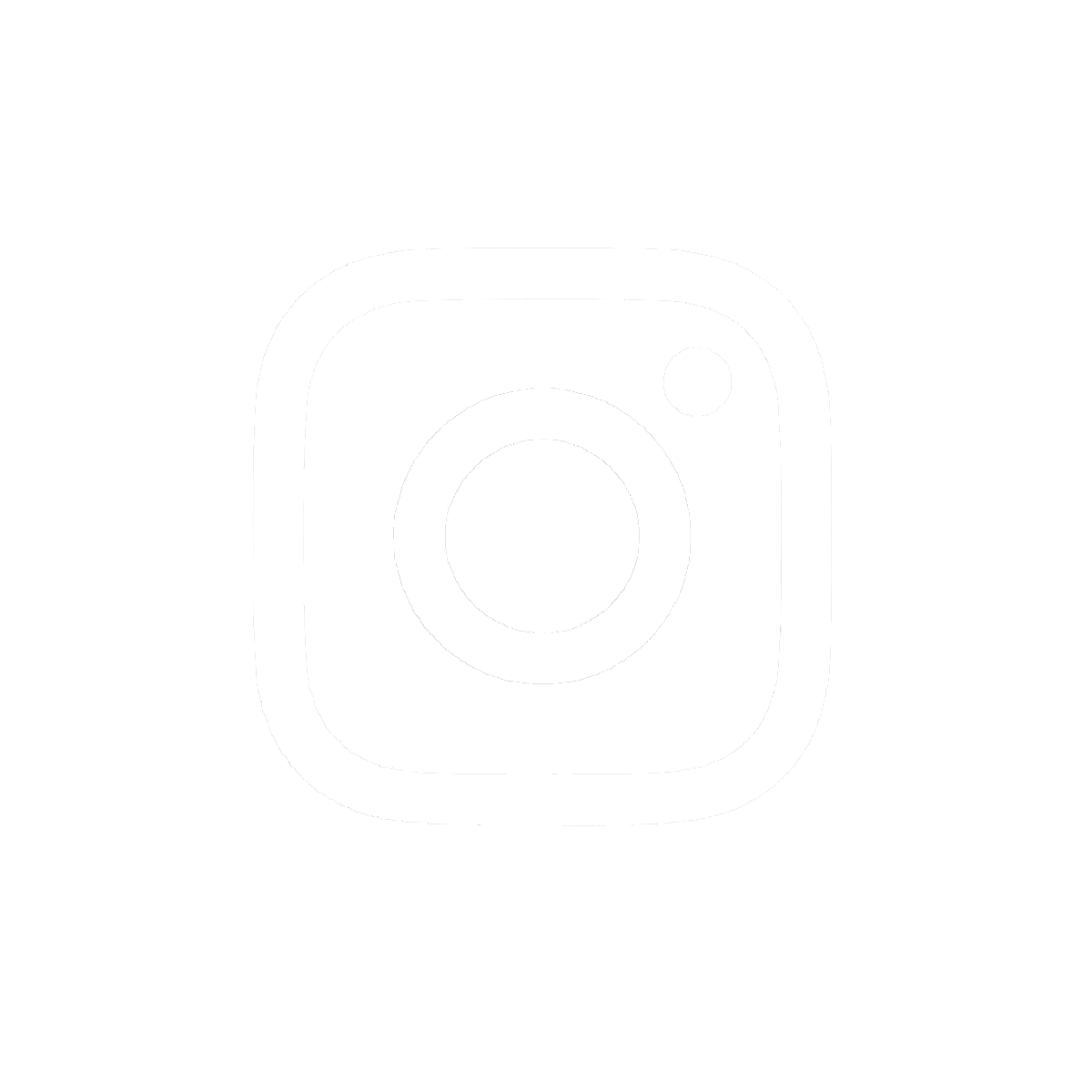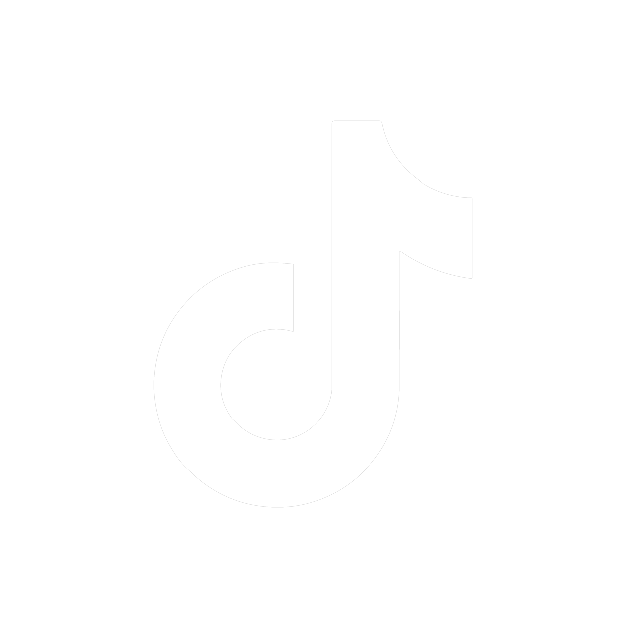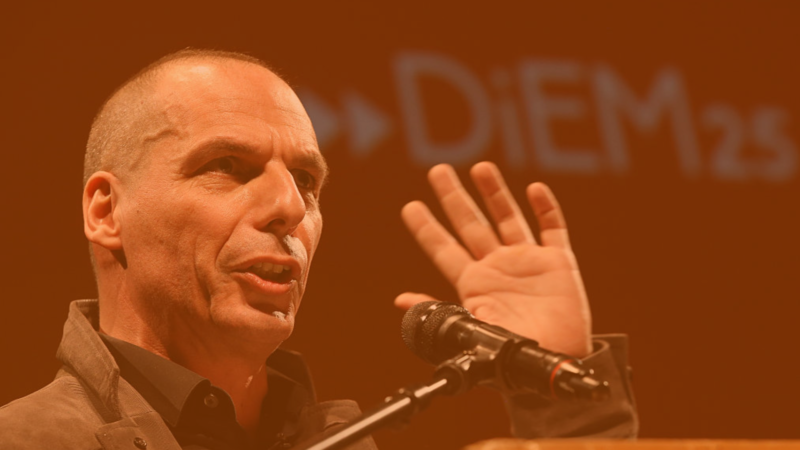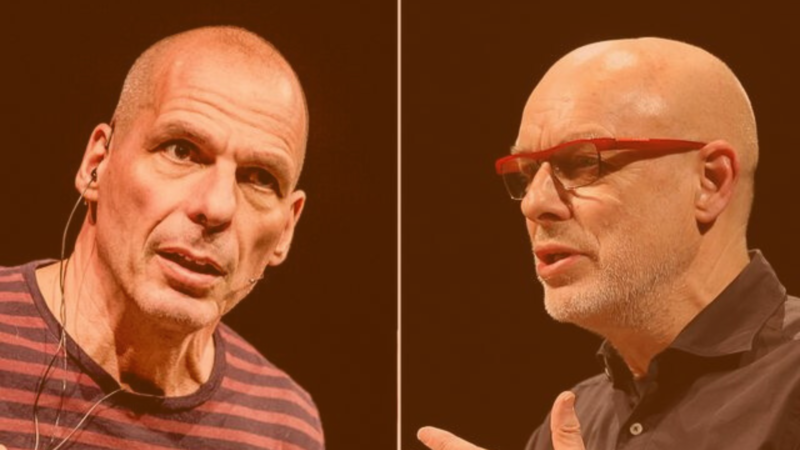Yanis Varoufakis détaille les grandes tendances mondiales à l’œuvre en 2025. Du retour de Trump aux évolutions du dollar, en passant par l’influence de la Chine, il explique les conséquences de ces développements sur la politique et l’économie mondiales.
En ce début d’année 2025, nous nous trouvons à un moment décisif, où les conséquences de décennies de politiques néolibérales se heurtent aux réalités d’un ordre politique mondial en mutation. Le jeu complexe entre Donald Trump, le dollar américain et la Chine illustre parfaitement les contradictions systémiques du capitalisme mondial.
Contradictions américaines et dilemme du dollar
Donald Trump, figure de proue d’une orthodoxie économique déclinante, fait face à un paradoxe emblématique de l’impasse dans laquelle se trouvent les États-Unis : réindustrialiser le pays, mais sans renoncer à la suprématie du dollar. L’ironie est manifeste. Un dollar plus faible permettrait pourtant de stimuler les exportations, mais les élites économiques, à la fois cibles des critiques de Trump et sources de son pouvoir, refusent de renoncer au « privilège exorbitant » que leur procure le dollar. Cette dualité révèle non seulement une contradiction politique, mais l’insoutenabilité du fondement même de l’économie américaine : un système accro à la dette commerciale, aux importations bon marché et à la spéculation financière.
L’obsession de Trump pour les droits de douane illustre la futilité d’une politique commerciale nationaliste dans un monde interconnecté. Au lieu de résoudre les failles structurelles de l’économie américaine, sa dépendance à la financiarisation et la fragilité de sa base industrielle, ces mesures risquent d’augmenter l’instabilité mondiale. Ironiquement, ce type d’instabilité augmente souvent la demande pour le dollar ; précisément l’inverse de ce que souhaite Trump. Le dollar se renforce, le déficit commercial se maintient, et les travailleurs américains continuent d’en payer le prix.
Baisses d’impôts et mirage de la croissance
La politique fiscale de Trump, sortie tout droit de la théorie du ruissellement, ne pourra que jeter de l’huile sur le feu. En baissant les impôts, Trump enrichit les ultra-riches et les grandes entreprises, accroît encore les inégalités, et renforce le dollar en attirant les capitaux étrangers. Les citoyens américains, eux, voient leur salaire stagner et les coûts augmenter, dans un système où les dés sont de plus en plus pipés en faveur d’une élite rentière.
L’économie américaine dépendante du statut mondial du dollar, ce « privilège exorbitant », reflète l’échec global du néolibéralisme. Ce privilège permet aux États-Unis de soutenir un déficit perpétuel, mais aggrave les inégalités économiques et entretient les déséquilibres géopolitiques. Et pourtant, toute velléité d’abandonner ce privilège insoutenable est politiquement toxique, puisque contraire aux intérêts des élites financières, qui bénéficient du statu quo.
Nouveaux accords du Plaza : une illusion
Certains estiment que la politique douanière de Trump s’insère dans une stratégie plus large, qui pourrait consister à négocier des accords de dévaluation monétaire avec des rivaux comme la Chine ou l’Union européenne, comme cela s’était fait lors des accords du Plaza, signés dans les années 80. Mais le monde de 2025 n’est plus celui de 1985. La Chine n’est pas le Japon, et son économie n’est pas asservie aux intérêts américains. L’idée de contraindre Beijing à réévaluer le yuan relève d’un fantasme typique de l’arrogance impériale, d’un refus de reconnaître la réalité multipolaire de l’économie mondiale d’aujourd’hui.
Au lieu de réformer significativement la finance et le commerce mondiaux, les politiques de Trump renforcent un système en échec, qui fait passer les gains à court terme de quelques-uns avant une stabilité à long terme pour tous.
La vraie question : Chine et piste de transformation
La clé de l’économie mondiale est à chercher non pas dans la vaine rhétorique de Washington, mais dans les décisions stratégiques prises à Beijing. Tandis que les États-Unis se débattent avec leurs propres contradictions, la Chine est face à un choix : doit-elle continuer de participer passivement à un système dominé par le dollar, ou oser redéfinir l’ordre économique mondial ?
Les BRICS pourraient par exemple devenir un contrepoids à l’alliance FMI/Banque mondiale, avec le yuan comme pierre d’achoppement d’un nouveau système de type Bretton Woods. Cela pourrait marquer le début de la fin pour l’hégémonie du dollar, et créer un environnement plus multipolaire pour la finance et le commerce mondiaux. Mais cela obligerait la Chine à assumer les risques et la responsabilité associés à une position de leader, dans un monde qui aspire à des changements systémiques.
Vers un futur post-capitaliste
2025 n’est pas seulement une nouvelle année d’incertitude économique, c’est l’heure de vérité. Les contradictions d’une économie mondiale centrée sur le dollar, les coûts sociaux et environnementaux générés par un capitalisme en roue libre, et le mécontentement croissant des gens ordinaires exigent des alternatives audacieuses et systémiques.
Il ne s’agit pas seulement d’un choix entre dollar fort et dollar faible, ou entre les droits de douane de Trump et la patience stratégique de la Chine. Le choix qui s’offre à nous est le suivant : poursuivre dans la voie de l’inégalité, de l’instabilité et des destructions de l’environnement, ou forger un nouveau paradigme économique centré sur la démocratie, la justice et la soutenabilité écologique.
La planète ne peut pas se permettre d’attendre que la Chine, Trump ou tout autre acteur isolé montre la voie. L’heure est à la solidarité internationale. L’heure est venue pour des mouvements comme DiEM25 de dessiner un futur post-capitaliste, capable de transcender l’étroitesse des simples intérêts nationaux. L’année 2025 ne nous place pas seulement à un carrefour économique, elle nous appelle à l’action.
Voulez-vous être informés des actions de DiEM25 ? Enregistrez-vous ici!