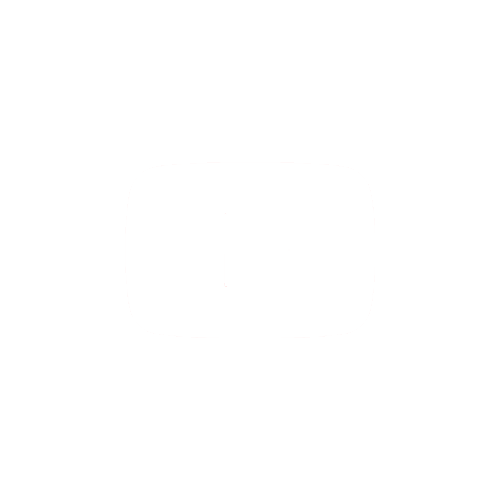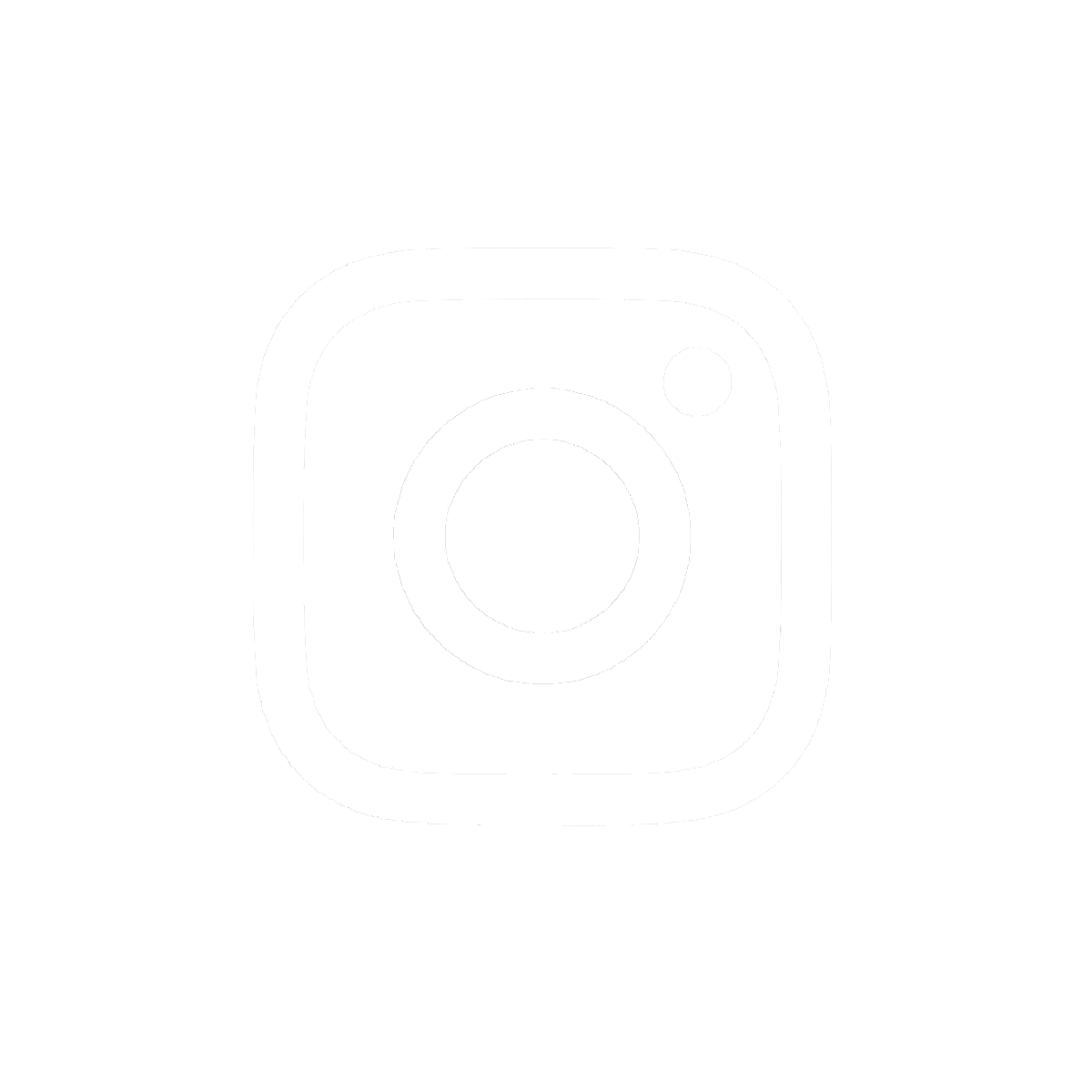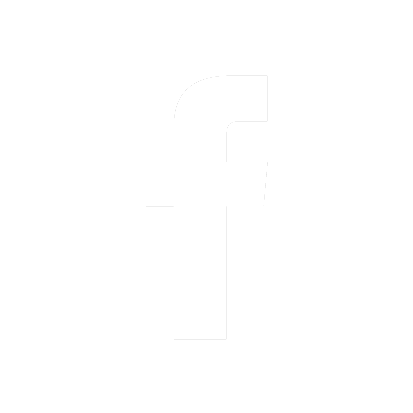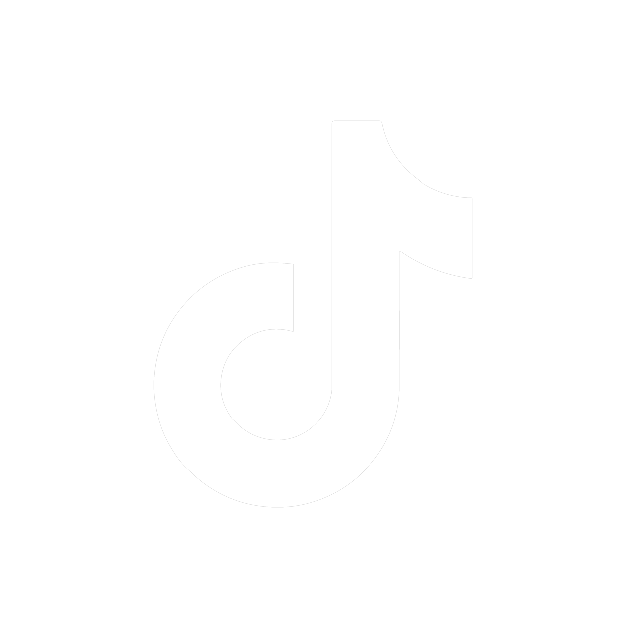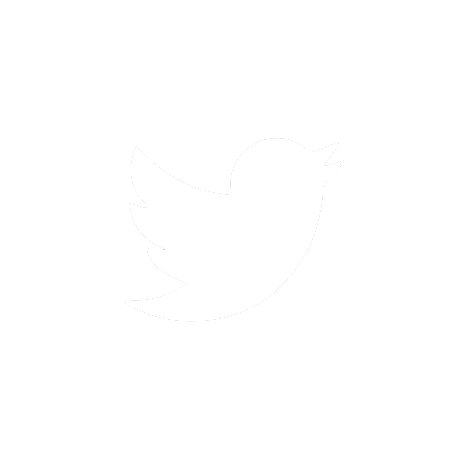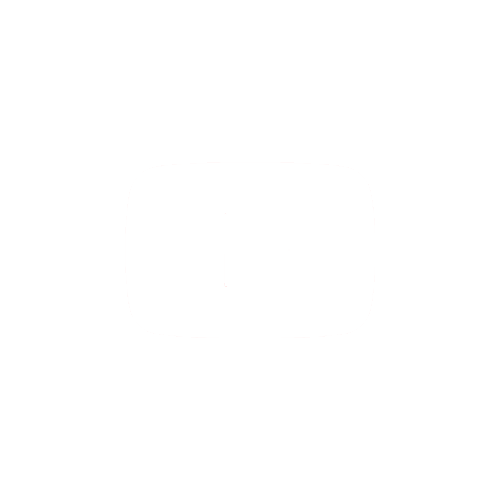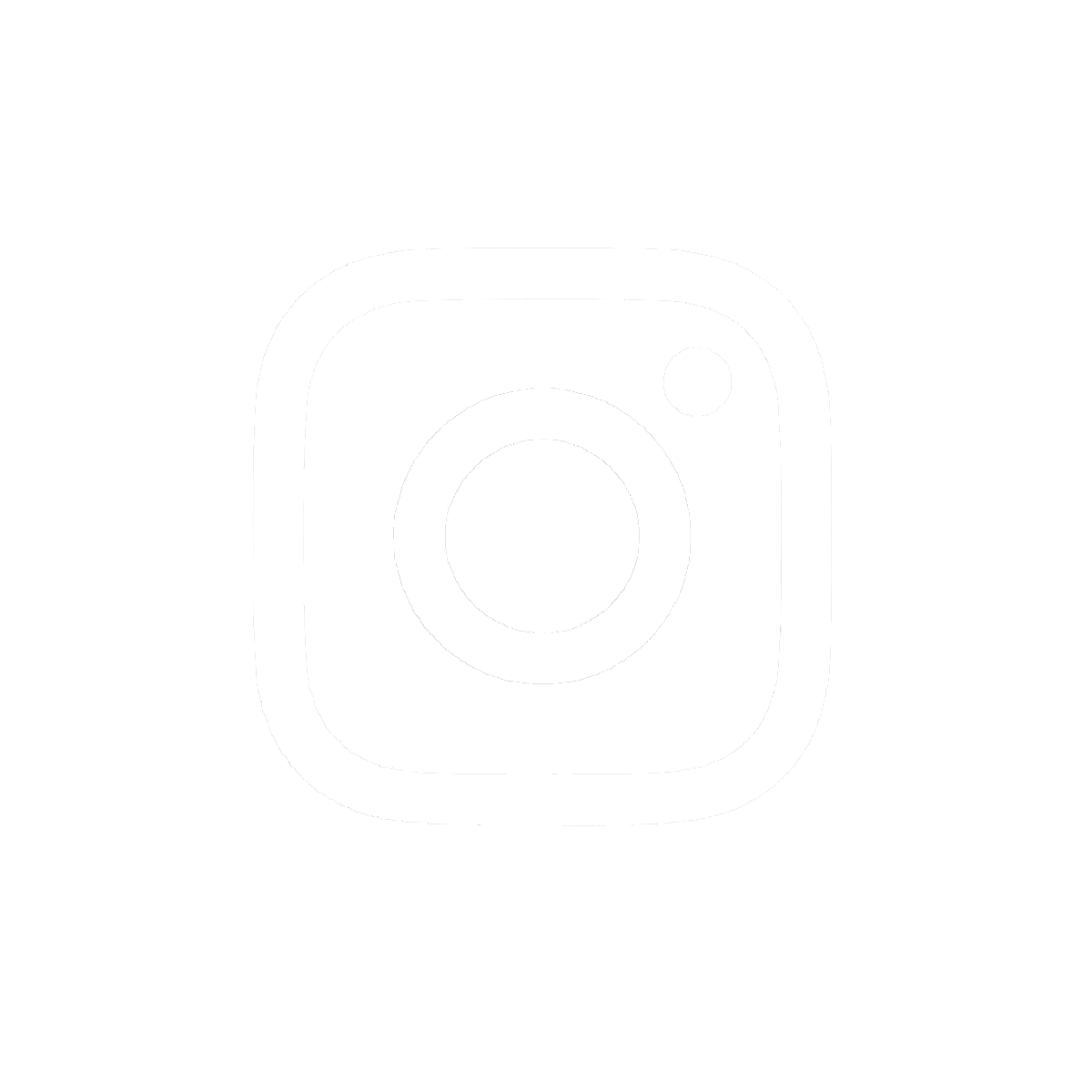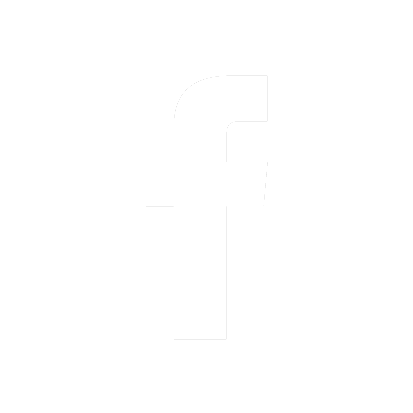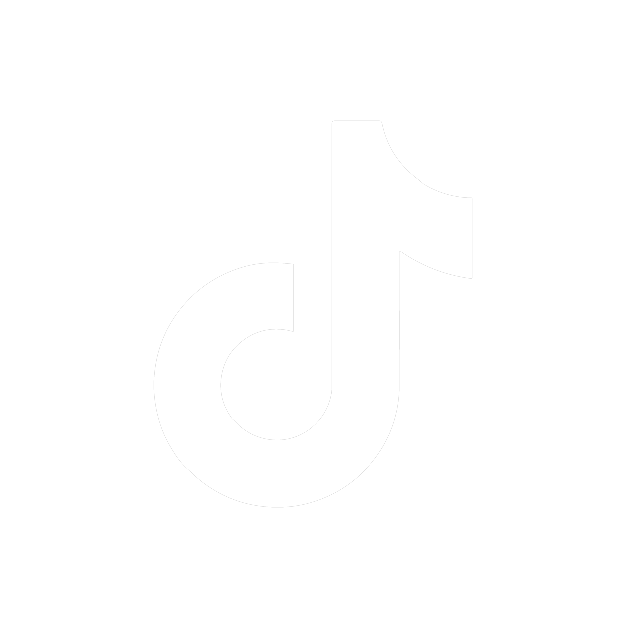« Avant notre confinement lié à la pandémie, la politique semblait être un jeu. »
ATHENES – Pour exorciser mes pires craintes concernant la décennie à venir, j’ai choisi d’en imaginer une chronique sombre. Si d’ici décembre 2030, les événements l’ont invalidée, j’espère que ces sombres pronostics auront été des aiguillons nous incitant à passer à l’action.
Avant le confinement induit par la pandémie, la politique semblait être un jeu. Les partis politiques se comportaient comme des équipes sportives avec de bons ou de mauvais jours, marquant des points dans un classement destiné à déterminer en fin de saison qui formerait un gouvernement et ensuite, ne faisant plus grand-chose.
Puis la pandémie de COVID-19 a fait craquer le vernis de l’indifférence pour révéler la réalité politique : certaines personnes ont le pouvoir de dire au reste d’entre nous ce qu’il faut faire.
La description de Lénine de la politique comme signifiant « qui fait quoi à qui » semblait plus appropriée que jamais. En juin 2020, alors que le déconfinement commençait à se mettre en place, la vision optimiste de gauche selon laquelle la pandémie allait raviver le pouvoir de l’État en faveur des plus faibles restait de mise, ce qui encourageait certains de mes amis à fantasmer sur une renaissance des biens communs et une définition large de la notion de biens publics. Comme je le leur rappelais, Margaret Thatcher avait laissé l’État britannique plus grand, plus puissant et plus concentré qu’elle ne l’avait trouvé en arrivant au pouvoir. Un État autoritaire était nécessaire pour soutenir des marchés contrôlés par les entreprises et les banques. Les pouvoirs en place n’ont jamais hésité à pratiquer un interventionnisme massif de l’État pour préserver les intérêts de l’oligarchie. Pourquoi une pandémie devrait-elle changer l’ordre des choses ?
Le coronavirus a failli emporter à la fois le Premier ministre britannique et le prince de Galles, et même la star la plus appréciée d’Hollywood. Mais en réalité, ce sont les plus pauvres et ceux à la peau plus foncée que la grande faucheuse a emportés : eux étaient faciles à faucher. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. L’impuissance engendre la pauvreté, qui fait vieillir les gens plus vite et, en fin de compte, les prépare à la mort. Dans le contexte de la chute des prix, des salaires et des taux d’intérêt, il a toujours été improbable que l’esprit de solidarité qui nous a animés pendant la période de confinement incitât l’État à mettre sa puissance au service des faibles et des vulnérables.
Au contraire, ce sont les grandes multinationales et les ultra-riches qui ont été les bénéficiaires du fait que le socialisme soit encore bien vivant. Craignant que les masses, piégées dans l’arène sauvage de marchés sans entraves pendant la catastrophe sanitaire, ne puissent plus se permettre d’acheter leurs produits, ils ont réorienté leurs dépenses vers l’acquisition d’actions, de yachts et de belles demeures. Grâce à l’avalanche de billets tout neufs que les banques centrales ont déversée sur eux via leurs financiers habituels, les marchés boursiers ont prospéré au fur et à mesure que les économies s’effondraient. Les banquiers de Wall Street ont soulagé la culpabilité qui les minait depuis 2008 en laissant les consommateurs de la classe moyenne se disputer les restes.
Les plans pour la transition verte que de jeunes militants pour le climat avaient mis à l’ordre du jour avant 2020 n’ont reçu qu’un soutien de pure forme, les gouvernements étant écrasés sous des montagnes de dettes. Quant à l’épargne de précaution pratiquée par de nombreux citoyens, elle a eu pour effet d’aggraver la dépression de l’économie, provoquant un mécontentement à échelle industrielle sur une planète qui brunit de jour en jour.
Le fossé entre le monde financier et le monde réel où des milliards de personnes ont dû lutter pour survivre s’est irrémédiablement creusé.
Et avec lui s’est accru le mécontentement qui a engendré les monstres politiques contre lesquels je mettais en garde mes amis de gauche.
Comme dans les années 1930, dans le cœur de beaucoup de gens, les raisins de la colère mûrissaient pour produire un nouveau vin amer. En lieu et place des caisses à savon des années 1930 sur lesquelles se juchaient les démagogues pour promettre aux masses mécontentes de leur rendre leur dignité, la nébuleuse « Big Tech » a fourni applications et réseaux sociaux parfaitement adaptés à ce but.
Une fois la société livrée à la peur de la contagion, les droits de l’homme étaient en passe de devenir un luxe inabordable. « Big Tech » développait des bracelets biométriques en mesure de surveiller nos données 24 heures sur 24. De mèche avec les gouvernements, elle associait les informations produites avec les données de géolocalisation, puis intégrait le tout dans des algorithmes afin d’envoyer aux gens des SMS préventifs leur enjoignant que faire et où aller pour éviter l’apparition de nouveaux foyers de contamination.
Mais un système capable de surveiller notre toux pourrait aussi surveiller nos rires. Il pourrait savoir comment notre tension artérielle réagit à la harangue du dirigeant politique, au discours galvanisant du patron, ou à la déclaration de la police interdisant une manifestation. Tout à coup, le KGB et Cambridge Analytica parurent appartenir à la préhistoire.
Le pouvoir de l’État ayant été relégitimé par la pandémie, de cyniques agitateurs en ont profité. Au lieu de soutenir les voix réclamant une coopération internationale, la Chine et les États-Unis ont renforcé le nationalisme. Ailleurs aussi, des dirigeants nationalistes ont alimenté la xénophobie et proposé aux citoyens démoralisés un marché sommaire : fierté personnelle et grandeur nationale en échange de pouvoirs autoritaires pour les protéger contre les virus mortels, les étrangers sournois et les dissidents comploteurs.
Tout comme les cathédrales ont été l’héritage culturel du Moyen-Âge, les années 2020 nous ont légué de hauts murs, des clôtures électrifiées, et des vols de drones de surveillance.
La renaissance de l’État-nation a rendu le monde moins ouvert, moins prospère et moins libre précisément pour ceux qui ont toujours eu du mal à voyager, à joindre les deux bouts, et à dire ce qu’ils pensent. Pour les oligarques et les responsables d’entreprises de la « Big Tech », de la « Big Pharma » et d’autres grandes multinationales, qui se sont entendus comme larrons en foire avec les hommes forts au pouvoir, la mondialisation s’est poursuivie à un rythme soutenu.
Le mythe du village planétaire a fait place à un équilibre entre des blocs de super-puissances, chacun d’entre eux disposant d’une armée en plein essor, de chaînes d’approvisionnement séparées, d’autocraties spécifiques et de divisions de classe renforcées par de nouvelles formes de nativisme. Les nouveaux clivages socio-économiques ont mis en relief les caractéristiques de la politique de chaque pays. Comme les gens qui deviennent les caricatures d’eux-mêmes lors d’une crise, des pays entiers se sont concentrés sur leurs illusions collectives, en exagérant et en cimentant les préjugés préexistants.
Ce qui a fait la grande force des nouveaux fascistes dans les années 2020, c’est que, contrairement à leurs ancêtres politiques, ils n’ont même pas eu à entrer au gouvernement pour prendre le pouvoir. Les partis libéraux et sociaux-démocrates se sont mis à rivaliser d’enthousiasme pour embrasser la xénophobie « light », puis l’autoritarisme « light », puis le totalitarisme « light ».
Alors, nous y voici, à la fin de la décennie. Où en sommes-nous ?
L’article original a été publié par FilmsForAction & Project Syndicate.
Voulez-vous être informés des actions de DiEM25 ? Enregistrez-vous ici!