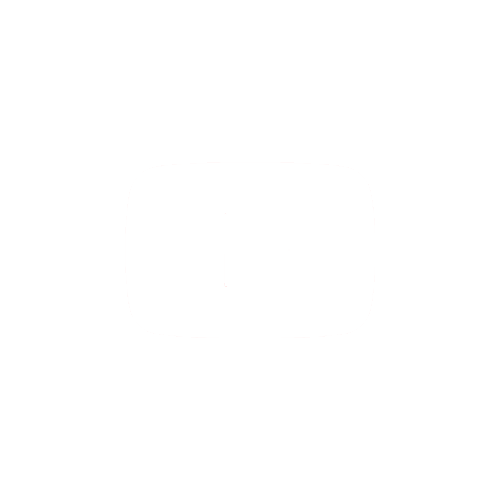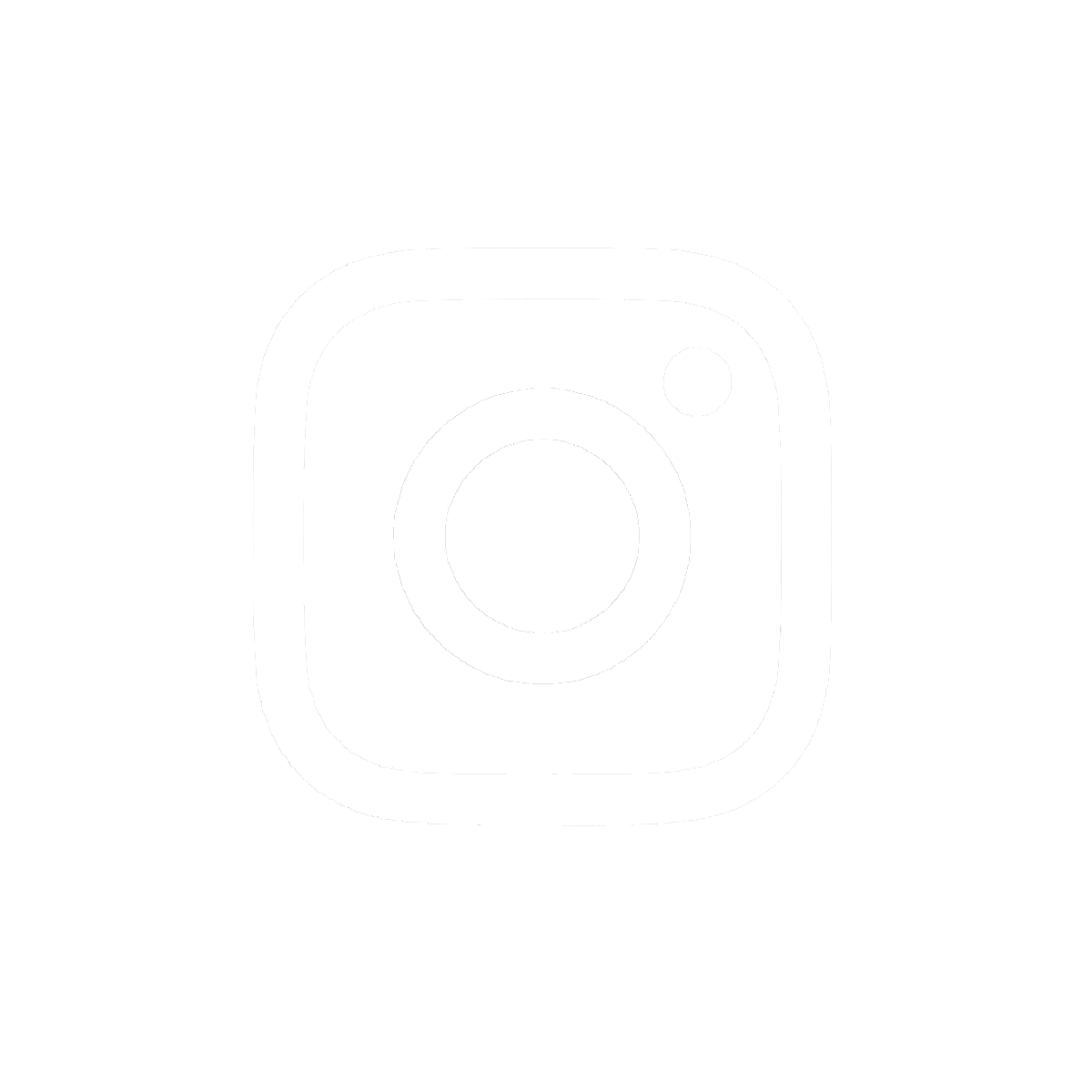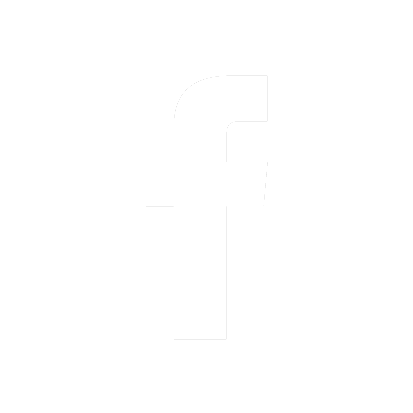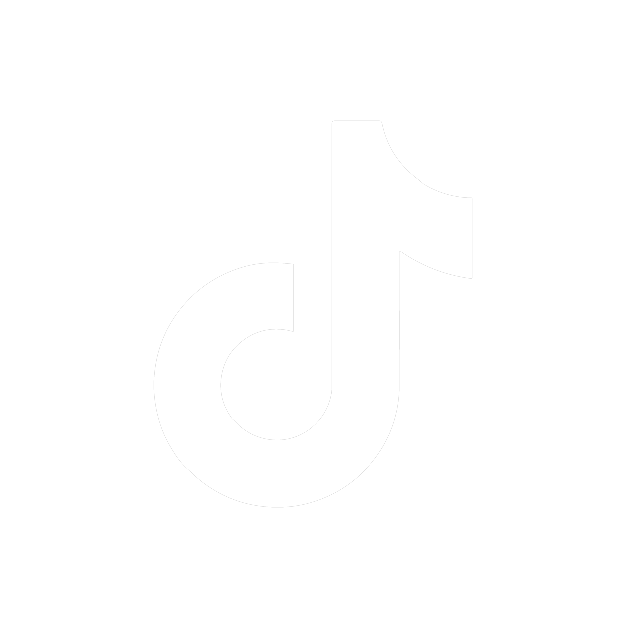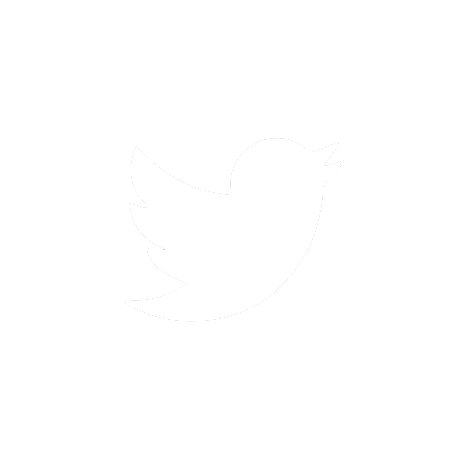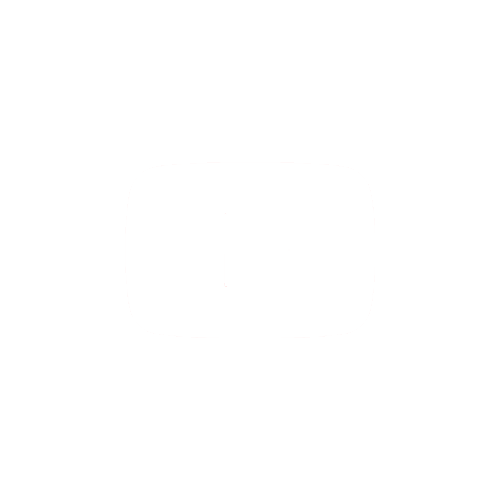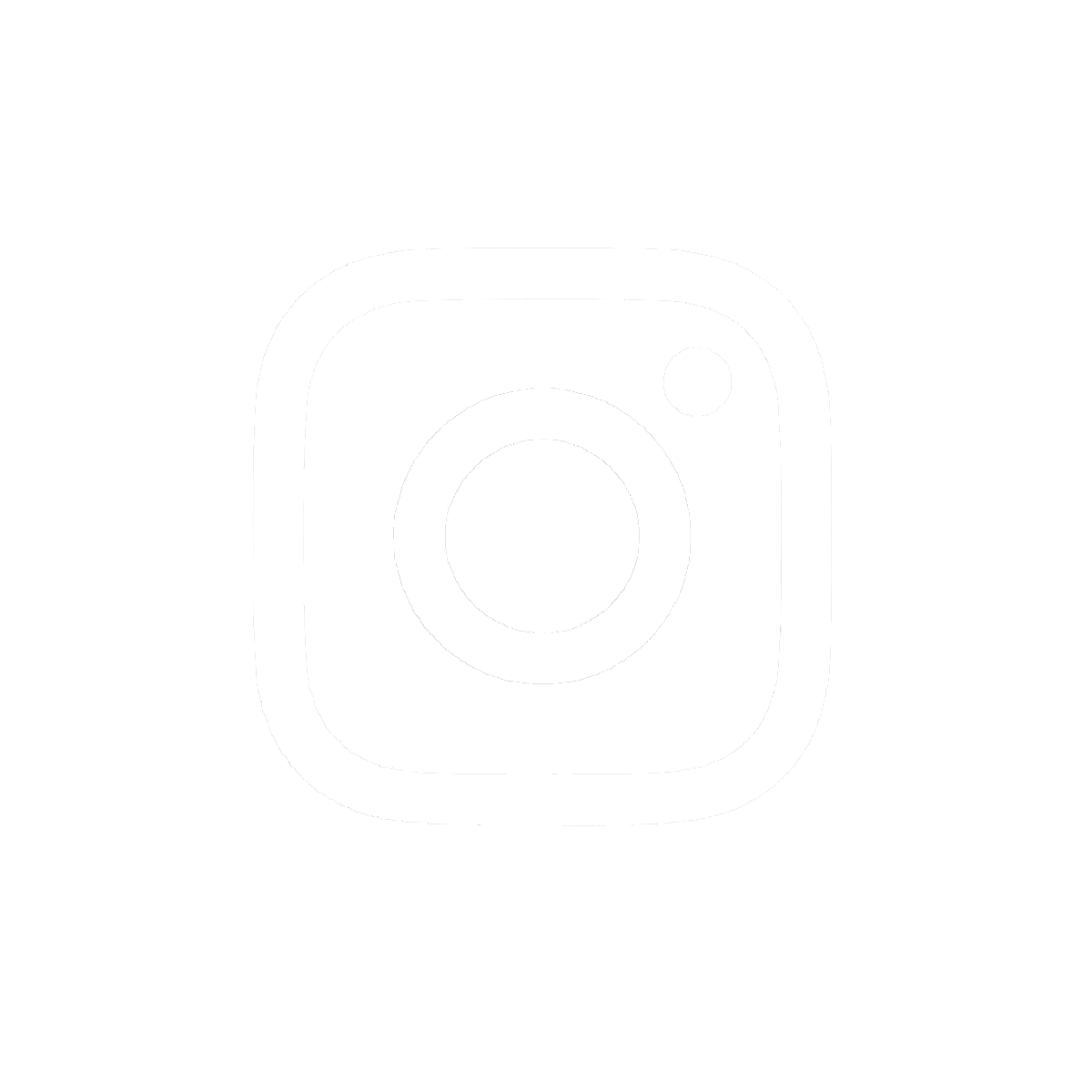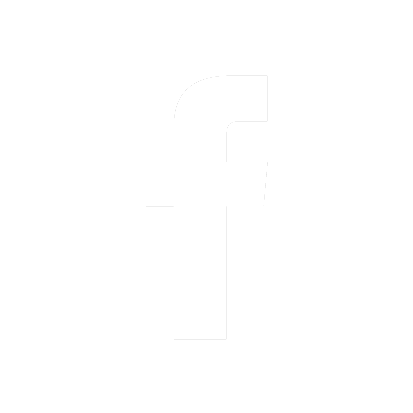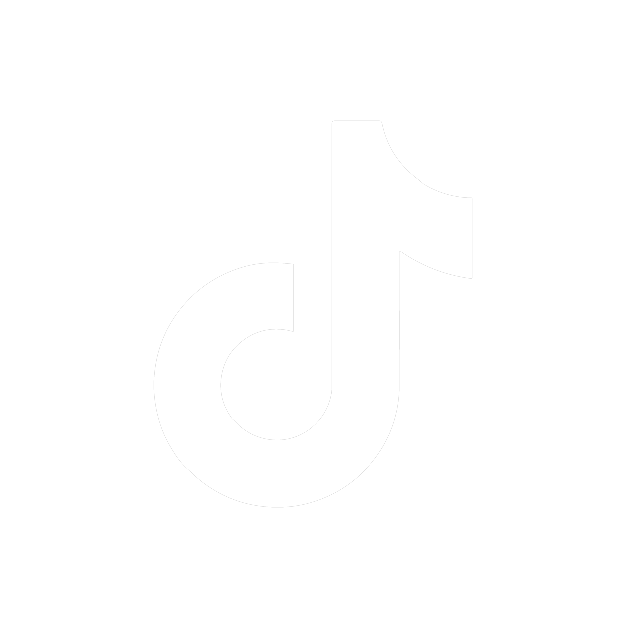« Il est essentiel de mettre fin à l’uberisation des économies afin que les peuples européens bénéficient tous de la protection inhérente au droit du travail lorsqu’ils sont subordonnés à des employeurs. »
L’uberisation est devenue si présente dans nos économies occidentales que le mot lui-même est entré en France dans le dictionnaire. Qui dit uberisation dit aussi nouvelle typologie de travailleurs, souvent au service des plateformes numériques. Or, le modèle économique de ces plateformes ne fonctionne que si elles se déchargent des coûts liés aux employés… et le plus souvent aussi de leurs charges fiscales (la plupart d’entre elles étant installées dans des paradis fiscaux ou des États à charge fiscale minimale).
Les plateformes numériques telles que UBER, Deliveroo, Take it Easy, Foodora ou Amazon n’emploient donc pas ceux qui leur permettent de faire leur chiffre d’affaires, mais se reposent sur des « prestataires freelance ». Les plateformes ont fait miroiter à des milliers de travailleurs les avantages à ne pas être salariés : liberté, horaires décalés, être son propre patron.
Le revers de la médaille était évident mais pas toujours mesuré par les concernés : n’étant pas salariés, ces travailleurs ne bénéficient pas de la protection du Code du Travail, ni des conventions collectives : congés payés, repos hebdomadaire obligatoire, salaire fixe, salaire minimum, causes de licenciement limitées, mais surtout protection sociale et retraite payées, en France par exemple pour moitié, par l’employeur.
Rapidement les travailleurs uberisés se sont aperçus que dans les faits ils ne bénéficiaient pas des avantages tant loués par les plateformes.
Quelle liberté lorsque les plateformes imposent les clients et les trajets à suivre ? Comment être son propre patron lorsque vous ne pouvez pas refuser une course ou un client au risque d’être mal noté et immédiatement éliminé de la liste des « prestataires » ? Quels horaires libres alors que vous ne fixez pas vos prix et que ceux qui vous sont imposés sont si bas qu’ils vous obligent à travailler jusqu’à mettre votre santé, voire votre vie, en danger ?
Ken Loach, dans son dernier film « Sorry we missed you », a illustré de façon flagrante la précarité dans laquelle l’uberisation du travail et des économies précipitent une partie de plus en plus grande des travailleurs avec à la clef des conséquences qui peuvent leur être fatales : « ici pas de relation employé-employeur » dixit le chef du dépôt dans le film de Loach : « tu nous rejoins à bord. On appelle ça l’onboarding. Ici tu ne travailles pas pour nous, tu travailles avec nous. Tu es le maître de ton propre destin. »
Les travailleurs uberisés sont devenus les nouveaux forçats de nos économies, corvéables à merci pour des revenus de misère (ce que le journal « The Australian » appelle, en référence aux films du même nom, « The Hunger Games at Work »), sans aucune protection sociale, pistés en permanence par la géolocalisation.
Beaucoup de grosses sociétés ont perçu le bénéfice qu’elles pouvaient tirer de cette main d’œuvre « flexible et jetable ». Ainsi certaines banques françaises ont récemment annoncé que leurs conseillers ne seraient bientôt plus embauchés mais incorporés en freelance.
En ces temps de crise du Coronavirus de grandes enseignes sont en train d’instaurer les mêmes schémas : en France, les supermarchés Franprix et Carrefour ont profité du début de cette crise pour uberiser une partie de leurs nouveaux livreurs, alors que leurs profits leur permettraient de continuer à embaucher des salariés.
A l’heure de la pandémie, la précarisation d’une grande partie des travailleurs devient plus visible.
Les auto-entrepreneurs n’ont non seulement plus aucun revenu mais de plus n’ont pas le droit au chômage. Ils n’ont pas ou peu accès aux services médicaux selon le pays dans lequel ils vivent. Or, parmi les travailleurs en première ligne se trouvent tous les livreurs qui assument les risques liés au virus pour livrer nourriture, DVDs et jouets à une population confinée.
Un grand nombre de clients habitués depuis quelques années maintenant à ces services ne se posent d’ailleurs nullement la question de la mise en danger d’autrui pour un coût qu’ils jugeraient sûrement dérisoire si ils ne choisissaient pas de fermer les yeux sur cette réalité, à l’instar, avant l’arrivée du virus, des hommes et des femmes politiques de gauche arrivant en Uber à des meetings de campagne là même où ils allaient dénoncer les conditions précaires et la sous-évaluation des revenus du travail.
Les ubérisés constituent un prolétariat que l’on n’entend pas car, n’étant pas salariés, ils ne disposent pas de représentants du personnel ni de syndicats.
Pour l’instant le salut vient de quelques courageux et de la justice qui s’est emparée du problème dans plusieurs pays européens et au-delà :
- En France, suite à de multiples accidents, la loi du 8 août 2016 a accordé aux uberisés que les plateformes les aident à financer l’assurance accident du travail que les employeurs prennent en charge habituellement ainsi que certains droits syndicaux et le droit à la formation. La Cour de Cassation avait déjà requalifié l’engagement d’ un uberisé de la plateforme Take It Easy en contrat de travail en 2018 considérant que la plateforme contrôlait le travailleur par la géolocalisation et que celui-ci n’était donc pas libre d’exercer sa profession à sa guise ;
- La justice espagnole a reconnu la qualification de salarié à un livreur Deliveroo ;
- La Cour d’Appel de Londres a accordé à des chauffeurs Uber un statut d’employé avec salaire minimum, droit aux pauses et congés payés, en décembre 2018 ;
- Aux Etats-Unis, Uber a accepté de payer jusqu’à 100 millions de dollars pour clore des recours de chauffeurs ;
- En Australie, Foodora a fermé après des poursuites gouvernementales menées par le Fair Work Ombudsman, trois travailleurs ayant dénoncé des rémunérations indécentes.
Plus récemment en France, le 20 mars dernier, la Cour de Cassation a démontré le lien de subordination entre la plateforme Uber et le travailleur freelance et, par un arrêt majeur, a requalifié ce genre de contrat de service en contrat de travail avec toutes les protections inhérentes au statut.
Les plateformes se sont plaintes que cela ruinerait leur modèle économique. On pourra arguer, ironiquement, qu’en 1848 certains hommes d’affaires ont aussi considéré que l’abolition de l’esclavage allait ruiner leur business, cela n’en fait pas une justification. Néanmoins le gouvernement d’Emmanuel Macron a immédiatement réagi en déclarant qu’il fallait inventer de nouvelles règles « permettant la liberté »… La liberté de qui ?
En ces temps de pandémie, de protection sanitaire synonyme de vie ou de mort, il est essentiel, sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, que DiEM25 impulse une réflexion transeuropéenne pour contrer les velléités des gouvernements néolibéraux alliés de ces plateformes qui ne paient même pas d’impôts dans les pays où ces travailleurs opèrent.
Elles doivent être tenues responsables de la situation dans laquelle elles poussent ces travailleurs d’un nouveau type. Il est essentiel de mettre fin à l’uberisation des économies afin que les peuples européens bénéficient tous de la protection inhérente au droit du travail lorsqu’ils sont subordonnés à des employeurs.
Voulez-vous être informés des actions de DiEM25 ? Enregistrez-vous ici!